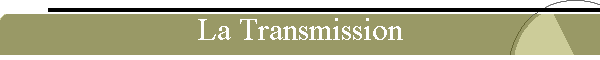La Transmission de la Bible
“Le ciel et la terre
passeront, mais mes paroles ne passeront point.”
Jésus Christ en Matthieu 24:35




La Bible et Archéologie
Manuscrits exemples 1 Manuscrits exemples 2
Déterminer le texte à imprimer
I. La Bible
est le produit de l’inspiration de Dieu. Nous pouvons
remercier Dieu d’avoir communiqué avec l’humanité et d’avoir
fait enregistrer cette communication.
2 Timothée 3:15,16
...Les saintes lettres... Toute Ecriture est inspirée de Dieu...
2 Pierre 1:21 C’est
poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la
part de Dieu.
II. Jésus a
promis que ses paroles (la Parole de Dieu) ne
disparaîtraient jamais.
A.
La plupart de ce qui a été écrit dans l’Antiquité a disparu depuis
longtemps.
1. Posidonius, le plus
célèbre des Rhodiens du II siècle avant J-C
a écrit une oeuvre appelée “Histoires universelles” qui n’existe plus.
2. Galien de Pergame (II
siècles avant J-C) est le plus célèbre
médecin de l’Antiquité. Selon Will Durant (vol.9, p. 102), “Des cinq
cents volumes qui lui sont attribués, il en reste cent dix-huit...”
3.
Il ne reste qu’un seul manuscrit grec qui contient l’oeuvre de
Tacite.
4. Les textes de César,
Tite-Live, Platon, Thucydide et Suétone ont
chacun moins de 21 manuscrits témoins.
5. L’Iliade de
Homère, écrit vers 900 ans avant J-C est connu par
643 manuscrits, le plus ancien datant d’environ 400 avant J-C.
6. “Erudits et savants ne
manquaient pas ; leur renommé
momentanée courait le monde,” dit Will Durant, historien laïque,
en parlant de la Syrie sous le régime romain. Il donne l’exemple
de Nicolas de Damas qui “ ne fut pas seulement le mentor
d’Antoine, de Cléopâtre et d’Hérode, mais il entreprit la lourde
tâche d’écrire une histoire universelle, labeur, devant lequel
Hercule lui-même aurait reculé. Le temps charitable a
englouti tous ses ouvrages ; apparemment il en fera autant
des nôtres” (Histoire de la civilisation, vol. 9, page 113).
B. Par contraste, la Parole de Dieu est abondamment attestée (prouvée).
1. 5 300 anciens manuscrits
grecs
2. Plus de 10 000 manuscrits
latins
3. Plus de 9 000 manuscrits dans d’autres traductions (“versions”)
anciennes
4. Les fragments de papyrus du Nouveau Testament les
plus vieux
(I et II siècles après J-C) témoignent de son origine pendant la vie
des tout-premiers chrétiens.
C. Il faut
remarquer la préservation miraculeuse du texte
biblique qui atteigne presqu’à la perfection.
En accomplissement des
paroles de Jésus, aucune parole des Ecritures Saintes n’a jamais été
perdue : elles sont toutes là, encore aujourd’hui, dans les manuscrits. Parler
d’une prétendue corruption du texte biblique n’est que l’incrédulité obstinée et
déraisonnable.
III. Résumé de la transmission de la Parole de
Dieu
A.
L’écriture existe depuis environ 3 000 ans avant J-C.
Les supports :
tablettes d’argile,
pierre, ostracon (les chutes de poterie
cassée), parchemin, papyrus, papier, ordinateur...
B. Moïse
(XV siècle av J-C) est le premier “écrivain” biblique.
Il a écrit les
5 premiers livres de la Bible (appelés Le Pentateuque “5 livres”). Il les a
écrits sur du parchemin. Les parchemins étaient cousus ensemble pour
former des “rouleaux” jusqu’à 40 mètres. On ne connaît pas quel style
d’écriture il utilisait, mais la langue était l’hébreu. Les Israélites, comme
la plupart des anciens, écrivaient dans les rouleaux. Au fur et à mesure
que les prophètes étaient “poussés” ou “inspirés” par Dieu, leurs écrits
étaient recueillis et distribués parmi les communautés juives. Quand
un manuscrit était devenu trop usé, on le plaçait dans une petite pièce.
Lorsque la pièce était remplie, ou qu’une persécution se déclenchait,
on allait enterrer les manuscrits en “terre sacrée”. On pense que
certaines des grottes de la Mer Morte étaient des “terres sacrées”.
C. La
première traduction a était écrite en langue grecque.
Cela
s’est passé à Alexandrie. Le roi égyptien Ptolémée Philadelphie
(285-246 av J-C) avait créé une grande bibliothèque pour y placer un
exemplaire de toute la littérature du monde. Cette traduction s’appelle
“La Version des Septante”, en souvenir des 70 personnes qui ont achevé
la traduction. Lorsque le Nouveau Testament fait une citation de l’Ancien
Testament, il empreinte souvent une partie de la “La Version des
Septante”. Aussi, le Nouveau Testament fait des citations directement du
texte hébreu.
D.
Puisque la langue hébraïque est très ancienne et à cause de
l’émigration des israélites dans divers pays, l’hébreu biblique est devenu
petit à petit incompréhensible aux gens. L’hébreu parlé est devenu
l’araméen. Il était donc nécessaire de traduire
en paraphrases
l’hébreu en araméen dans les synagogues.
Ces traductions
spontanées étaient appelées des “targums”. Plus tard, on écrivait
les “targums” aussi. Quelques citations dans le Nouveau Testament
viennent aussi de ces “targums”. Nous pensons que Jésus parlait
l’araméen mais lisait aussi l’hébreu.
E.
Après l’Ascension de Jésus Christ, le Saint
Esprit a poussé
(inspiré) certains des disciples de Jésus à rédiger les Evangiles.
Aussi a-t-il poussé Paul, Jean et d’autres à rédiger les divers livres que
nous appelons “le Nouveau Testament”. Tout au début ces écrits sur
papyrus circulaient comme des oeuvres indépendantes (2 Timothée 4:13 ;
Colossiens 4:16). On peut supposer que dans chaque communauté
chrétienne, plusieurs personnes prenaient le temps de recopier
chaque nouvel “Epître” avant de l’envoyer à la prochaine communauté.
1. Ces copies devaient être assez nombreuses car pendant les
premiers trois siècles de notre ère, quand les romains persécutaient
les chrétiens (au début dans une région à la fois et plus tard dans
tout l’empire), on cherchait systématiquement les livres sacrés pour
les détruire. En dépit de toute cette destruction, la Bible est
parvenue jusqu’à nous dans ces langues d’origine !
2. Une fois que la religion chrétienne ait été agréée, Constantin le
Grand ( dans l’année 331) a commandé 50 Bibles entières en
langue grecque, aux frais de la trésorie impériale. Ces Bibles
devaient être placées dans les églises que Constantin prévoyait
de faire construire. Un des plus anciens manuscrits grecs de la
Bible entière semble faire partie de ces 50 à cause de son “style
luxueux” et du fait qu’ils datent du IV siècle. C’est le "Codex
Vaticanus."
3. Pour les documents du Nouveau Testament, comme pour les
nombreux écrits profanes de l’Antiquité, chaque papyrus et
chaque parchemin se détruisait avec le temps. C’est ainsi que
très peu de documents très anciens sont parvenus jusqu’à nous.
La majorité des anciens manuscrits conservés aujourd’hui viennent
des régions au climat sec, tels l’Egypte et les alentours de la Mer
Morte. Seules les oeuvres recopiées nous ont été transmises.
4. Après l’invention du “Codex” (le livre à feuilles reliées qui a
remplacé le rouleau), les diverses parties du Nouveau Testament
circulaient en groupes : soit les Evangiles, soit les Epîtres de Paul,
soit les Epîtres Générales (Jacques, Pierre, Jean, Jude), soit les
Actes des Apôtres, soit l’Apocalypse. Il était impossible de relier
tous les 26 livres du Nouveau Testament par un même relieur.
Quand il s’agit d’une Bible entière, celle-ci comprend plusieurs
volumes. Pour économiser les matériaux, il arrivait de relier des
oeuvres littéraires non bibliques dans un même volume avec des
livres bibliques. C’est ainsi que certains livres apocryphes ont été
transmis jusqu’à nous.
5. En Occident, on copiait surtout en latin la Vulgate de Jérôme.
Cinq traditions différentes de la Vulgate se sont développées à
travers les siècles. Vers l’année 800, Alcuin (conseilleur
intellectuel de Charlemagne) a essayé de rétablir le pur texte de
Jérôme. Les copistes étaient surtout des moines. Dans l’Orient,
on copiait des manuscrits correspondant à sa propre langue.
Le texte grec a été copié à la main jusqu’au XVI, malgré l’existence
de l’imprimerie depuis plus d’un siècle ! L’église orthodoxe grecque
produisait aussi des “Lectionnaires”, c’est-à-dire des portions des
évangiles à lire dans le culte le dimanche. Ce sont des manuscrits
grecs ayant moins de valeur historique.
6. Avant Alcuin, les manuscrits littéraires étaient écrits en lettres
majuscules. Les oeuvres manuscrites étaient très chères. Alcuin a
adapté les lettres cursives en lettres “minuscules”, permettant
d’économiser la place, etc. (Jusqu’alors les lettres cursives ne se
servaient que pour les écrits non littéraires telle que la
correspondance.)
F. A
l’origine tout le Nouveau Testament était rédigé en langue
grecque, la langue “internationale” de l’époque,
comme la langue
latine au moyen âge, la langue française aux XVII et XVIII siècles et la
langue anglaise aujourd’hui. Au fur et à mesure que le message de Jésus
Christ s’est répandu dans les divers pays, les chrétiens devaient, comme
les juifs auparavant, faire des traductions spontanées dans les églises. Plus
tard les traductions ont été écrites.
1. Les versions en vieux
latin entre 150 et 400 ap J-C
2. Les versions en vieux
syriaque à partir de l’année 150
3. Les versions égyptiennes
(sahadique, bohairique) à partir de 250
4. La traduction gothique d’Ulfilas (mort en 381)
5. La Vulgate de Jérôme (dont les Evangiles ont été achevés en 384)
6. La version géorgien V
siècle
7. La version arménienne V
siècle
8. La version éthiopienne VI
siècle
9. Une traduction en arabe
VII siècle, qui est disparue
10. Une traduction slave IX
siècle
11. Des parties plus ou moins importantes ont été traduites en
anglo-saxon (VII ou VIII siècle) ; occitan (au plus tard XI siècle par
les Cathares, dont le seul exemplaire survivant est à Lyon) ; vieux
français XII siècle (pour Pierre Valdo, puis colporté par les “Pauvres
de Lyon), en vieil italien par les Vaudois en Savoie orientale). La
Bible de l’Université de Paris en 1250.
**********************************************************************************************
L’imprimerie a été
introduite en Europe au XIV siècle mais attendait l’invention
des caractères mobiles par Johannes Gutenberg pour devenir efficace. Fin de
l’époque manuelle (“à la main”). Désormais notre compréhension du monde sera
transformée par la technologie. Nous aurons de plus en plus de mal à
comprendre “les anciens”. En ce qui concerne les manuscrits, on ne comprend
plus rien. Nous achetons des journaux et des livres très facilement. A
l’époque
avant l’imprimerie, un livre aurait coûté, disons deux --peut-être plusieurs--
belles
vaches, une petite fortune! Un seul livre représentait entre un et trois ans de
travail partagé entre plusieurs personnes. Notre époque de “perfectionnisme
informatique” n’a rien à voir avec l’homme romain ou médiéval. L’optique de
multiplication avant l’imprimerie était : “chaque copie est unique et bonne
malgré
l’erreur humaine” ; mais l’optique moderne de multiplication est :
“grand tirage mécanique, identique et (en principe) sans erreur”.
**********************************************************************************************
G. La
publication du texte grecque imprimé commence avec
Erasme, 1516, une année avant le début de la Réforme.
En 1522 la
“Polyglotte Complutensienne” est sortie avec “l’imprimatur” du pape,
c’est-à-dire son autorisation ecclésiastique. Robert Estienne “Stephanus”
imprimeur du roi de France a sorti 4 éditions entre 1546 et 1551 (Paris,
puis Genève). Dans son édition de 1550 il a ajouté en bas de page les
“variantes” de 15 manuscrits grecques. C’est le début de la “critique
textuelle” pour perfectionner le texte grec imprimé. Neuf éditions
ont étaient imprimées par Théodore Beza, huguenot, entre 1565 et 1604.
Les frères Elzévir ont publié 7 éditions 1624 et 1678. De leur
introduction est venue la petite phrase “textus receptus” (le texte
reçu),
titre du texte traditionnellement imprimé jusqu’en 1881. Entre-temps, de
plus en plus de manuscrits grecs devenaient disponibles aux érudits pour
vérification du texte biblique. En résultat de ces recherches, on a
déterminé que le texte biblique est 98,33% indemne d’erreur pour le
Nouveau Testament et 99,9% pour l’Ancien Testament. La
confirmation de cette conclusion a été apportée par la découverte de plus
de 150 manuscrits (surtout de l’Ancien Testament) dans la région de la
Mer Morte dont le fragment le plus vieux est du IV siècle avant J-C et dont
le plus précieux est le rouleau entier d’Esaïe du II siècle avant J-C. La
grande partie des erreurs sont des fautes d’orthographe. Ainsi, l’oeuvre
du “critique textuel” ne concerne qu’une partie infime du texte
biblique : 0,1%.
H. La Bible
aujourd’hui est un objet presque quotidien et
disponible -- au moins en partie -- dans plus de 2 000 langues.
Dans
certaines langues, telles que le français et l’anglais, la Bible est
disponible en multiples versions. La première en français a été faite en
1530 à partir du latin par Lefèvre d’Etaples. La seconde a été traduite
depuis le grec et l’hébreu par son étudiant Olivétan. L’impression a été
financée par le peuple vaudois pour le peuple français en 1535. La
traduction d’Olivétan a servi de base pour plusieurs révisions
(toujours faites à partir des langues originales) dont les plus célèbres
sont l’Ostervald (1744) et la Segond (1910). Le CD “La
Bible Online”
contient la Bible dans de nombreuses langues différentes, plus 3 éditions
du texte grec et 2 éditions du texte hébraïque. La Bible en français est
présentée en trois versions sur le CD.
Voici deux
citations en conclusion :
1. Concernant le texte
biblique : “Douter de l’exactitude du texte
biblique, c’est de vouer toute la littérature de l’Antiquité à
l’obscurité, car aucun document ancien n’est aussi bien attesté
bibliographiquement que le Nouveau Testament.”
2. Concernant l’exactitude
des données dans les récits bibliques :
“On peut affirmer catégoriquement qu’aucune découverte
archéologique n’a jamais démenti une référence biblique.”
Nelson GLUEK, archéologue
remonter
![]()
![]()